Prolongements en classe :
Physique-chimie : Travail sur le son
-Activité N°1 : Quel est le rôle de chacune des parties d’une guitare ?
-Activité N°2 : Comment relier la perception d’un son à ses caractéristiques physiques ?
-Activité N°3 : Comment éviter les risques auditifs ?
-Activité N°4 : Comment lutter contre les nuisances sonores ?
-Activité N°5 : Comment déterminer la vitesse de propagation d’un signal sonore ?
-Activité N°6 : Comment construire une flute de pan avec le matériel du laboratoire ?
Mathématiques :
1ere Partie : Les mathématiques et la musique :
- La musique, une affaire d'arithmétique
- L’harmonie d’une musique ; gamme, cohérence et Pythagore
2ième partie : les mathématiques et le son
- Découverte d’une nouvelle fonction : la fonction logarithme
- Travail autour de l’intensité sonore : comment atténuer un son ?
Français :
Les élèves réaliseront leur propre carnet de voyage autour des différents sous-thèmes liés à la découverte de la cathédrale et au quartier médiéval. Madame Aubin, bibliothécaire spécialisée dans la pratique du carnet de voyage, les accompagnera dans le cadre de ce travail. Enfin, un concert de musique médiévale, avec la découverte d’instruments d’époque, est également envisagé.
EPS : Danses médiévales : découverte de quelques danses puis exploration/reprise de gestuelles types parmi les imposés de la création de la chorégraphie de groupe.
Arts plastiques : Nombre d’artistes (plasticiens et compositeurs) cherchent la relation intime et directe entre les arts plastiques et la musique.
Dés1750, le physicien LB Castel crée un clavecin oculaire qui fait correspondre les notes et les couleurs, le compositeur R Wagner rêve d’un art total qui mêle couleur, image, danse et musique. Le peintre Kandinsky cherche dans l’abstraction de la musique une voie pour l’abstraction picturale, empruntant le vocabulaire musical pour les titres de ses compositions, il s’inspire de la musique du compositeur Schoenberg maître du dodécaphonisme.
L’artiste plasticien Marcel Duchamp recherche une nouvelle forme de noter les partitions pour les rendre plus « plastiques » les compositeurs John Cage, Marton Feldman auront les mêmes préoccupations.
La musique est une source d’inspiration constante pour les plasticien et vice versa, ces deux formes d’arts étant intimement liés : Mondrian qui transcrit le jazz dans ses compositions et en retour inspire des formations jazz new-yorkaises, Le collectif Fluxus qui inventent des protocoles pour créer des partitions (déplacement de poisson dans un aquarium, tire au pistolet sur des partitions vierges …..)
Pour l’art contemporain qui cherche une porosité dans tous les domaines, la relation arts et musiques est d’une inspiration infinie.
Le projet :
Après avoir évoqué les différentes expériences des artistes plasticiens avec la musique ou des compositeurs avec les arts plastiques, les élèves choisiront un « instrument » (véritable instrument de musique, voix ou objet sonore)
Les élèves praticiens ou possédant une instrument pourront l’apporter
Dans un travail individuel, ils devront représenter par une forme abstraite (formes et couleurs) le son émis par leur objet sonore sur un support papier de format demi raisin à la peinture.
Cet exercice sera précédé d’une phase d’expérimentation.
Les élèves réaliseront une composition collective avec les représentations des sons, ils pourront augmenter ou diminuer la taille des représentations pour agir sur le volume, répéter plusieurs fois la même représentation pour agir sur le rythme.
Cette composition plastiques-partition pourra être jouée.
Histoire :Les métiers au moyen Age. Préparation du voyage à Guédelon.
-Les sons du Moyen-Age :
Les sons constituent, dans toute société, une part essentielle de l’environnement quotidien, sans qu’on n’y prenne garde le plus souvent.
C’est ainsi que l’historien Alain Corbin utilise l’expression « paysage sonore » dans son étude sur l’histoire sensible de la société à partir d’une recherche sur les cloches au XIXe siècle. Au Moyen Âge, la cloche est accordée avec soin pour émettre un son unique et puissant dans un environnement donné. Ce son doit être immédiatement reconnaissable par des oreilles éduquées, car il s’agit de répondre à la nécessité de rythmer la vie quotidienne, d’alerter, d’inviter aux réjouissances ou de susciter des émotions ou du recueillement. Les volées de cloches liées aux fêtes et aux célébrations créent une ambiance qui contraste avec le caractère lugubre du tintement du glas, de la cloche du tocsin, ou du silence du Temps pascal lorsque se taisent toutes les cloches.
Le son des grelots en métal précieux fixés sur les bourses et les poches des riches bourgeois avec sa fonction ostentatoire et de « signal anti-vol », ne peut être confondu avec le son des grelots des mendiants, des fous et des malades ou avec les sonnailles des animaux autorisés à circuler dans les rues.
Les sons et bruits des métiers, charpentiers, forgerons, orfèvres, tisseurs, et bien d’autres encore constituent une ambiance sonore propre aux villages et villes médiévales.
De même qu’un chanteur de rue ou un crieur public prennent en compte l’espace acoustique de la halle du marché, de la place ou de la rue dans laquelle ils évoluent pour adapter leur manière de chanter.
-La musique médiévale
Deux types de musique vont coexister au Moyen Âge : la musique religieuse et la musique profane.
La musique religieuse est constituée essentiellement de ce qu’on appelle le chant grégorien. C’est une mélodie chantée a capella (c’est-à-dire sans accompagnement d’instruments), à l’unisson (avec une seule voix) et sans rythme. Les moines, qui étaient les seuls à savoir écrire et lire, ont composé ces chants sur des parchemins.
La musique profane a pour unique objet de distraire. Des musiciens ambulants jouaient sur les places des villages pour amuser et faire danser les habitants. Les « troubadours » (ou « trouvères ») composaient des chansons qui parlaient d’amour.
Le programme étant centré sur l’espace méditerranéen et les échanges ou confrontations entre les espaces occidentaux chrétiens, byzantins orthodoxes et arabo-musulman, une place sera faite à la musique arabo-andalouse La musique arabo-andalouse médiévale est un art musical qui joue le rôle d’un pont entre différentes cultures. Elle maintient un lien fort avec l’espace et le temps, la géographie et l’histoire, ayant un impact profond depuis plus d’un millénaire sur les générations. Ce genre musical est associé à la nostalgie, évoquant la mémoire d’une coexistence harmonieuse dans l’Andalousie musulmane.
-Les instruments de musique
Les instruments de l’époque sont : la vielle, le luth, le tambour et le sistre (instrument à percussion sur lequel s’entrechoquent des coquilles, des coques de fruits, des rondelles métalliques…).
Le Moyen Âge marque aussi les débuts de la polyphonie : plusieurs voix se répondent ou se chevauchent. Va, rossignol, de Clément Janequin (1485-1558), très célèbre chanson, avec une superposition de cinq voix, en est un parfait exemple. La musique médiévale va s’enrichir progressivement et marquer, dès le début du XVe siècle, le début de la période suivante : la Renaissance.
Tâches finales : Restitution au musée lapidaire à la nuit des musées fin mai.
Intervenants et collaborateurs :
-Irène Verpiot : service des publics, direction des Musées et du patrimoine (coordination, interventions, toutes les séances)
-Nicolas Lombard : enseignant missionné à la Direction des Musées et du Patrimoine (écriture, coordination).
-Union compagnonnique du tour de France des devoirs unis
-Marie Hélène Pardoën : Archéologue du paysage sonore, ingénieure de recherche au CNRS.
-Compagnie théâtrale Arc en scène (musique et théâtre)
II.Le plus grand musée de France :
En 2013, la Sauvegarde de l’Art Français lance une campagne en faveur du patrimoine mobilier de nos communes : Le Plus Grand Musée de France (PGMF). Pour la Sauvegarde, le plus grand musée de notre pays est celui de nos territoires : chaque place, église ou mairie donne à voir des merveilles d’art qui sont bien souvent délaissées. Cette campagne, initiée par des étudiants de toutes disciplines, mobilise désormais, en plus des salariés de grandes entreprises, des amateurs d’art et des lycéens.
Plus de 3 000 participants ont déjà permis la restauration de plus de 250 œuvres en réunissant 1,7 million d’euros. Grâce à ces derniers, des œuvres d’art sont sauvées, des métiers d’art sont préservés et surtout des villages entiers prennent connaissance de l’existence de leurs trésors.
La classe Sciences et patrimoine a été choisie par la fondation de la sauvegarde de l’art français pour choisir quelle œuvre locale sera restaurée.
Déroulé :
-Le projet sera expliqué aux élèves le 26 septembre 2025 de 14H à 16H en présence de Mr Strasberg , Mme Philomène Vuillard, responsable du PGMF. Les métiers du patrimoine seront également évoqués. Les 5 œuvres retenues seront présentées aux élèves.
-Le mardi 14 octobre 2025, visite en bus payé par PGMF des 5 œuvres en présence de Mme Vuillard, Mr Strasberg,l’équipe enseignante.
Les élèves seront accueillis par les maires des 5 communes où se trouvent les œuvres à restaurer. Mr Strasberg détaillera l’histoire de chaque œuvre, ses péripéties, et les techniques de restauration envisagées etc…
-En AP histoire (encadrés par Mr Mathey et Mme Thibaudet), les élèves par groupe de 6 ou 7 prépareront un argumentaire pour défendre l’une des 5 œuvres. Ils devront faire des recherches et contacter les mairies pour avoir de plus amples informations sur chaque œuvre.
-En français : Mme Leclercq sensibilisera les élèves sur l’argumentation à travers deux séquences :
✗ « Quand l’art fait débat » - Les élèves découvriront ainsi comment les écrivains et les journalistes expriment leurs propres préoccupations esthétiques à travers leurs écrits sur l’art. La création artistique fait l’objet de questionnements tout en se nourrissant de scandales et de ruptures qu’il conviendra d’étudier grâce aux œuvres majeures des « Refusés » par l’Académie. Trois œuvres manifestes de la peinture réaliste seront ainsi mises en avant : « Le Déjeuner sur l’herbe » d’Édouard Manet, « Un Enterrement à Ornans » de Gustave Courbet et « Les Raboteurs de parquet » de Gustave Caillebotte. Elles seront associées à la réflexion de Charles Baudelaire sur la notion du « Beau » dans Salon de 1846, sans oublier le poème « Les Phares » qu’il consacre aux peintres qu’il admire. La lecture de l’essai de Jean-Paul Sartre, Qu’est-ce que la littérature ? invitera les élèves à remettre en cause certains préjugés sur la peinture. Une réflexion sur l’art contemporain sera engagée à partir des Essais de Philippe Muray et complétée par la lecture cursive de la pièce Art de Yasmina Reza.
✗ « Mots contre maux » - La deuxième séquence d’enseignement conduira les élèves à apprendre à argumenter en analysant des œuvres relevant de la littérature d’idées et de la presse, qu’il s’agisse de textes engagés en faveur de l’abolition de la peine de mort (Guy de Maupassant, « Le Condamné à mort »), de problèmes sociaux passés ou contemporains, voire d’affaires politiques (Émile Zola, « J’accuse »). Ainsi, ils découvriront comment l’écriture d’articles de presse s’appuie sur des anecdotes personnelles, à la manière de Colette, ou bien de faits réels, comme les préoccupations liées au climat dans l’essai d’Audrey Garric, « Greta Thunberg et les jeunes marchent pour le climat à Paris ». L’étude du lexique de l’art oratoire complétera cette approche : en effet, les élèves devront savoir argumenter en faveur d’œuvres qu’ils défendront pour « la sauvegarde du patrimoine ».
-Fin janvier (date à fixer) , en présence de Mr Strasberg, Mme Vuillard, 2 responsables de chaque commune, Le crédit agricole, Mmes Thibaudet et Leclercq, Mr Mathey un concours d’éloquence aura lieu (Salle Bussy Rabutin) Chaque groupe avec un support visuel défendra pendant 5 à 10 minutes l’œuvre choisie.
Un débat suivra cette présentation puis un vrai vote des élèves sera organisé en Bussy-Rabutin.
Le dépouillement sera immédiat et un chèque de 10000 euros sera donné immédiatement par le crédit agricole au responsable de la commune concernée ;





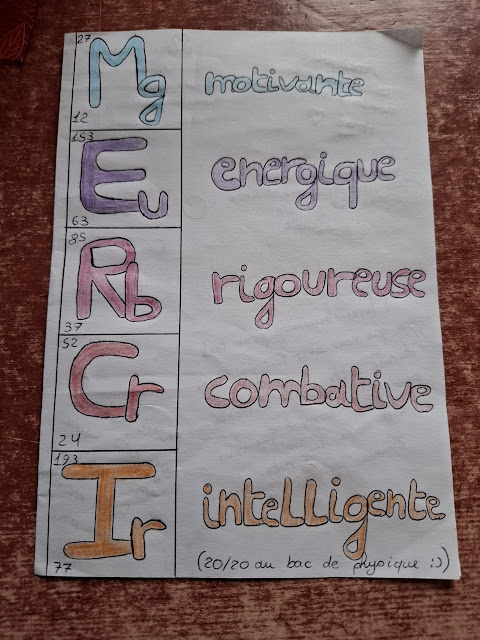





.jpg)





























